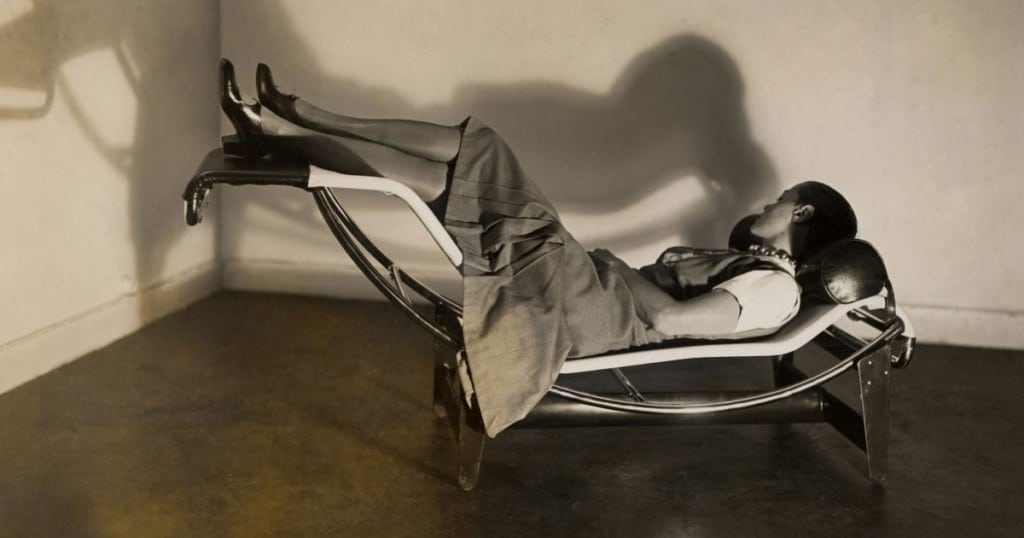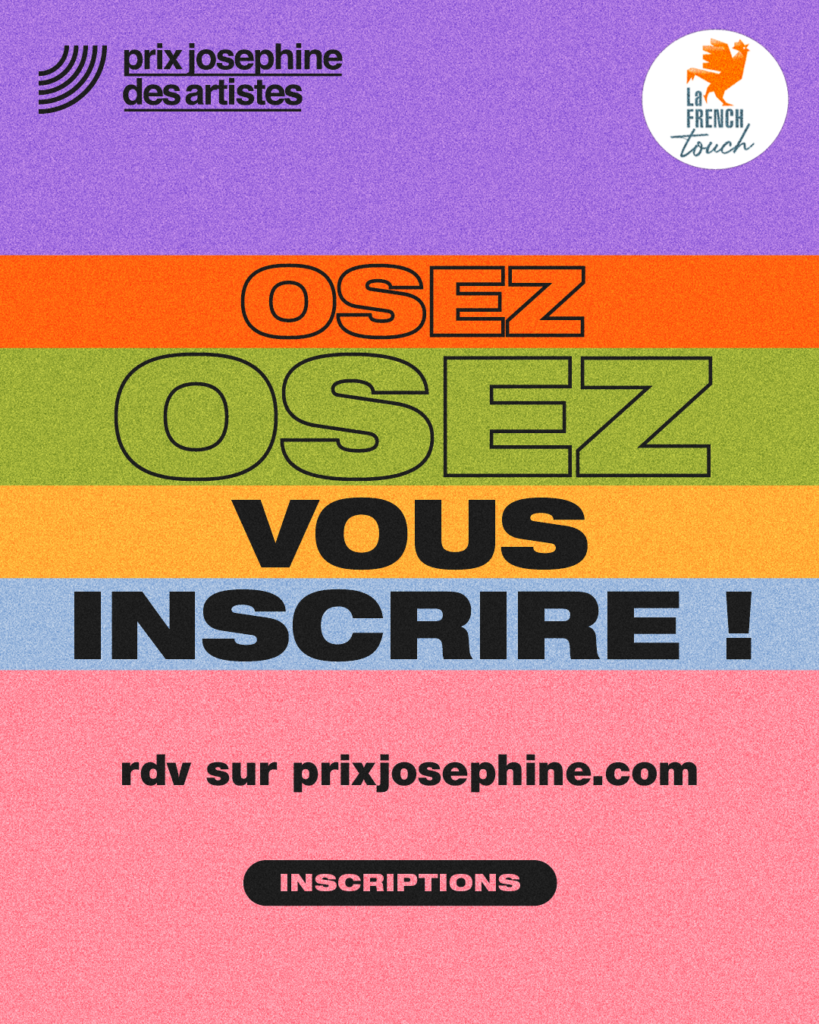Hélène Aguilar : « Pour modifier notre rapport au monde, changeons notre conception du beau ! »
Architectes, designers et artisans sont de plus nombreux à s’interroger sur la soutenabilité de leurs métiers et à souhaiter, aussi, accorder leurs pratiques aux exigences et conditions d’habitabilité de la Terre. Et si le beau pouvait nous aider à nous affranchir de certaines pratiques délétères pour la planète ? La French Touch a ainsi interrogé Hélène Aguilar, l’auteure du podcast « Où est le beau ? » afin de comprendre comment beauté et durabilité peuvent s’associer dans ces disciplines qui nous sont chères.

À partir du 24 mai prochain, le Pavillon français de la 19e édition de la Biennale d’Architecture de Venise présentera « Vivre avec ». Cette exposition proposée par les agences Jakob + MacFarlane et Eric Daniel-Lacombe interroge le rôle de l’architecture face aux enjeux écologiques, aux conflits et à l’instabilité du monde. L’occasion pour la French Touch de questionner la notion du beau à la lumière de la sombre réalité de notre époque. Pour nous aider à définir sa conception et à comprendre comment mettre en œuvre cette nécessaire évolution à l’heure des crises nous avons tendu le micro à Hélène Aguilar, instigatrice de « Où est le beau ? », podcast sur l’engagement en architecture, design, matériaux et botanique (environ 200 épisodes), et cofondatrice de la biennale parisienne « Amour Vivant ». La prochaine édition à l’automne 2025 présentera une sélection d’artisanat écologiquement soutenable, contribuant à ouvrir une nouvelle ère pour le design et l’architecture. Suivons là !
La French Touch : Après une première vie professionnelle comme juriste, vous avez lancé « Où est le beau ? », un podcast sur l’art de vivre à l’heure de l’Anthropocène. Puis vous avez cofondé la biennale « Amour Vivant » ainsi que, plus récemment, l’expérience « Cosmos & Matter. The new normal ». Comment tout a commencé ?
Hélène Aguilar : Le podcast est né d’une crise existentielle qui m’a fait comprendre que ce qui me rendait profondément joyeuse prenait tout simplement sa source dans la question du « beau ». Ce questionnement m'a amenée à explorer des sujets que je connaissais peu à l’époque mais qui me fascinaient, le design, l’architecture, l'artisanat. J’ai lancé mon podcast en 2019. À l'époque, le podcast était un univers encore émergent. La « question signature » que je pose à chaque invité du podcast : « Que représente le beau pour vous ? ». À travers mes interviews, j'ai appris que le choix des matériaux, qu'il s'agisse de nos objets, de nos intérieurs ou logements, a un impact immense sur notre environnement. Chaque créateur a un pouvoir réel dans le monde, car les matériaux qu'il choisit affectent profondément notre environnement et par effet rebond la manière dont nous interagissons avec lui. Cette prise de conscience a révélé l'énorme défi auquel nous faisons face : nous vivons dans un monde aux ressources limitées, et notre notion de beauté devra s'adapter à cette réalité. Aussi notre relation intime au beau est impactée. Face à l’écoanxiété qui m’a traversée, j'ai compris que l'on vivait une sorte de révolution silencieuse, où les goûts, les préférences et les pratiques des créateurs allaient changer. Tout comme celles des esthètes. Un réveil, presque systémique, allait survenir, surtout parmi les jeunes créateurs qui, influencés par des questions de soutenabilité et d'impact, se sont mis à chercher des solutions plus alignées, s’éloignant ainsi du modèle de consommation et de production qui jusqu’alors faisait référence. C'est une aventure passionnante, car je vois une nouvelle génération de créatifs qui veut participer à la solution, en créant un « beau » qui respecte la biosphère. Le podcast, malgré son succès, a des limites, car il ne permet pas au public de toucher. J’ai eu l'idée de créer un autre format, une biennale qui permette au grand public de prendre conscience des matériaux, de la beauté et de la durabilité. C’est ainsi qu’en 2021 est né « Frugal » puis « Amour Vivant » (dont la prochaine édition aura lieu, à l’automne, dans Paris). Car, au final, tout le monde, qu’il soit informé ou non, se retrouve face à ce paradoxe : nous créons un « beau » qui pourrait nous détruire. Mais je reste optimiste, persuadée qu'à force de partager des rôles modèles, nos goûts évolueront progressivement. C’est une aventure essentielle, car, pour changer notre rapport au monde, il faut d'abord changer notre manière de concevoir le « beau ». Et cette transformation est en marche, lentement mais sûrement.
La FT : Ces dernières années, on a vu le vivant occuper une place de plus en plus importante dans les disciplines créatives. De quelle façon ce mouvement se concrétise-t-il dans l’art de vivre et le design ?
HA : Je répondrais par une expérience que j’ai vécue et qui m’a confortée dans l’idée que l’opposé du beau, ce n’est pas le laid, mais la perversion du beau. Le beau, tel que le système le promeut aujourd’hui, crée l’illusion d’une abondance infinie, mais, en réalité, il génère la pénurie et la déconnexion du vivant. En 2020, j’ai initiée une exposition baptisée « Demain plus beau » avec la complicité du salon Maison & Objet. Cette exposition ne montrait que des matériaux sans plastique, avec une scénographie 100% en cueillette : de la terre crue, des bambous, des pierres... C’était tout en contraste avec les autres scénographies du salon, ultra sophistiquées, composées d’éléments en polystyrène, etc. Deux visions du monde. Et ce fut incroyable de voir que les visiteurs passaient deux fois plus de temps sur notre installation, à toucher, à ressentir ces matériaux naturels. Cette expérience m’a confirmé que notre lien avec le vivant, est là, bien présent et nos cellules le ressentent naturellement. Il est de l’ordre de la kinesthésie. En questionnant notre relation au beau, en nous demandant comment élever notre regard sur le beau, je pense qu’on peut réactiver notre lien avec la nature, qui, selon moi, est ininterrompu. Bien sûr, cela peut être compliqué, car nous avons des habitudes, et s’en défaire n’est pas facile. Pour designers et artistes, c’est un terrain créatif qui les enthousiasme, mais pour d’autres, notamment artisans et architectes, cela peut être bien plus compliqué. Si leur signature esthétique repose sur des matériaux non soutenables pour la planète, changer de matériaux implique d’ouvrir leur "matériauthèque" à des choses qu'ils connaissent moins. Et cela peut nuire à leur style, à leur signature. Cela soulève cette question : comment rester fidèle à sa signature tout en faisant évoluer son travail ? Je pense que c'est plus facile lorsque vous sortez de l’école et que vous n’êtes pas encore connu et aimé pour votre style.
La FT : La création pourrait finalement contribuer à nous reconnecter à la nature ?
HA : En tout cas, c'est un vecteur sous-estimé. La bascule est avant tout culturelle et évidemment de tout temps, comme le disait Jean-Luc Godard, ce sont les « marges qui font la page ». Dans les marges il y a des artistes, des designers, des architectes, des urbanistes aussi.
La FT : Le bâtiment est un enjeu majeur de la transition écologique. Vous êtes en partenariat avec Plendi, la filiale luxe de Vinci Construction, d’abord sur votre podcast, ensuite sur « les Rencards du beau », un format de rendez-vous. Comment cette remise en cause s’exprime précisément en architecture ? Pour quelles solutions ? Quelles sont les clés de la soutenabilité dans ce secteur ?
HA : Nos « Rencards du Beau » viennent nourrir et questionner, depuis 2022, un pôle de prescripteurs, des architectes et des architectes d'intérieur œuvrant dans le domaine du luxe et de « l'hospitality ». Parce que, dans ces métiers soumis aux fortes contraintes techniques des ERP (Établissements Recevant du Public), on assiste à une course à la compréhension des enjeux. Sur la question du choix des matériaux, mais aussi des techniques de construction, de « process »... Par exemple, au rang des questions : quelles alternatives pour des piscines et spa sans chlore ? Comment assurer les projets avec beaucoup de réemploi ? Qu’apporte un paysagiste en planification de l’avant-projet ? La question du modèle économique est également centrale. Enfin, la formation est très importante. On apprend notamment à identifier les matériaux dont les charges environnementales sont les plus faibles. Notre collectif aide, à travers ces rendez-vous, à faire de ces questions un point de bascule vers de nouveaux réflexes, modèles et filières. Les porteurs de projet qui innovent et prennent des risques, que j’ai beaucoup rencontré avec le podcast, n’ont souvent pas les moyens financiers de se faire connaître. Faire savoir est un défi en soi. C’est pourquoi, avec Marie-Cassandre Bultheel (cofondatrice de la Biennale Vivant) nous les mettons en lumière avec notre association qui a été reconnue d’intérêt général. Ces initiatives restent fragiles.
La FT : Lorsqu’on pense architecture durable, on pense d’abord matériaux, techniques, normes… Vous ajoutez une autre dimension qui est celle du « savoir-être ». Pourquoi ?
HA : Pour faire changer durablement nos pratiques et nos usages, le « mindset », c’est-à-dire la façon de penser, l’état d’esprit, est le préalable, sinon ça ne marchera pas. Du point de vue de l’usager : aujourd'hui, nous passons presque 90% de notre temps à l'intérieur d'une boîte que ce soit un appartement, une maison, un bureau, un train… Le rapport à la matière et au bâtiment passe donc aussi par nos sens. Comment cela est-il vécu et perçu ? Comment cela est-il traversé par nos usages, par nos gestes, par nos attentions ? Et les réponses passent par notre corps ! Du point de vue créatif, il existe cette nouvelle garde de designers et d’architectes, se voyant submergés par la question de la finitude des ressources et par l’intensification des catastrophes climatiques, qui ont besoin de retrouver le contact avec la matière, d'incarner ce qu’ils font, de ne plus être que derrière un ordinateur, de remettre du lien, de retrouver du sens aussi. Par ces nouvelles postures, ils ringardisent des postures empreintes d’égo ou motivées par l’envie de laisser une trace, qui étaient couronnées de succès les dernières décennies. Aujourd’hui la question qui se pose à cette nouvelle génération de designers et d’architectes est de savoir quel sens cela a. Et comment l’usager va se sentir à l'intérieur des projets qu’ils imaginent. Et cette posture permet, au passage, de réhabiliter l’humain : l’homme n’est certainement pas un cancer pour la planète. Au contraire, il a un rôle à jouer par son intelligence, par le fait qu'on se mette en lien, qu'on détienne de formidables moyens de communication et d’informations au service du changement. Donnons l’exemple de la céramiste qui, au lieu d’acheter sa terre dans un magasin (souvent mélangée et à la provenance obscure), préfère la cueillir près de chez elle dans des puits d’argile spontanés. Rien que ce geste va permettre de colorer différemment son processus de création parce qu’il la relie intimement au vivant et qu’elle aura ainsi naturellement envie d’honorer cette matière, de dialoguer et non de la contrôler. Là encore, c’est une relation qui passe par le corps.
La FT : Comment relier la démarche unique de l’artisan à l’indispensable passage à l’échelle, afin que, effectivement, cette soutenabilité ne soit pas marginale ?
HA : Il me semble qu’il faudrait se demander si l’on ne doit pas déconstruire cette opposition toujours apparente entre une démarche pionnière et son passage à l'échelle. Parce que ce qui est important avant tout, c'est le fait de démontrer qu’il est possible de faire autrement ! Et, c’est ce que ces éclaireurs permettent de faire. Ce qui est, à mon avis, très important, c'est notre discernement : « débunker » les fausses bonnes idées. Par exemple, l'économie circulaire du plastique est une illusion, car ce matériau reste fondamentalement linéaire à l'échelle d'une vie humaine. Pire encore, elle impose paradoxalement l’usage de plastique vierge. La priorité est de réduire le plastique aux usages essentiels, de recarboner nos sols.... Mais le plus grand passage à l’échelle qui s’opère actuellement est celui de la preuve et du désir. Dans le bâtiment, les solutions existent, et ce sont souvent des pratiques vernaculaires oubliées qui questionnent justement le lien entre le territoire et les ressources de ce territoire. L'histoire a toujours montré que les changements profonds ne se font pas uniquement par la réglementation et l'innovation technique, mais aussi par une transformation culturelle. Quand on met le doigt dans l’engrenage, le retour en arrière n’est plus possible. On dépasse aussi les effets de mode parce que la prise de conscience s’appuie sur des faits tangibles : l'épuisement des ressources, la pollution visible, les impasses économiques de certains modèles extra-activistes, etc. Je fais confiance à l’énergie et la conscience humaines. Le plus souhaitable des passages à l’échelle est celui de cette énergie humaine orientée au profit des alternatives les plus soutenables pour nous tous.

Crédit_Maxime_Gambiez
La FT : En référence au philosophe Baptiste Morizot et à l’écrivain Alain Damasio, vous utilisez le terme de « cosmopolitesse ». Quelle est la force des mots dans la transition que nous devons opérer ?
HA : Les mots façonnent le réel, ce sont des boussoles, des catalyseurs d'action, des passeurs d'imaginaire. Ils permettent d'ouvrir des espaces de pensée. Quand le terme « Anthropocène » est apparu , il a changé notre rapport au temps, notre rapport à nos responsabilités, etc. Le fait aussi qu'on soit passé de l’expression « développement durable » à « habitabilité du monde » ouvre d'autres imaginaires beaucoup plus désirables… De la même façon qu’il existe aujourd’hui une alternative au vocabulaire technique, avec des termes comme « nuisible », « ressource », « stock ». Les philosophes du vivant, comme Baptiste Morizot, préfèrent parler de « peuple des rivières », d’« alliés du sol »… Ce faisant, ils réorientent nos actions. Je suis fan de l’expression « cosmopolitesse », c’est-à-dire être poli avec le cosmos, parce qu’il nous projette immédiatement dans un nouvel art de vivre, dans de nouveaux rituels de cohabitation avec le vivant. Les mots permettent de mettre rapidement en circulation ces envies, ce dialogue rompu avec le vivant, et c'est essentiel. De nouveaux métiers vont apparaitre, car la médiation est indispensable.
La FT : Pour finir, quelle est votre définition du beau ?
HA : J’ai réalisé que ce qui m’émeut le plus, c’est tout ce qui passe par le corps. De plus en plus, j’essaye d’avoir mon propre corps comme boussole. C’est nouveau pour moi, et cela transforme ma relation à mes pensées, à ce que je perçois visuellement, à toutes les références culturelles et aux conditionnements dont je suis imprégnée. Ce n’est plus mon mental qui prend les rênes, et cela est fascinant à auto-observer. C’est une aventure vertigineuse, initiatique, qui m’emmène bien plus loin que ce que j’imaginais il y a sept ans, lorsque je me suis posé ces questions pour la première fois pour le podcast. Mais pour ça, il faut s’autoriser à se faire confiance. Je réalise combien il est difficile d’assumer des goûts singuliers, dans un monde où nos goûts sont liés à la norme, à la classe sociale, à une certaine idée du beau. Tout cela nous freine et nous empêche d’être pleinement sincères avec nous-mêmes. Mais quand on accepte de briser ces barrières, qu’on se demande honnêtement ce qui nous touche, sans se soucier du regard des autres, alors quelque chose de puissant se passe. On accède à une forme de liberté incroyable. L’émerveillement et le beau ont une puissance trop souvent sous-estimée – même si ces notions mériteraient d’être questionnées collectivement dans le débat public. Un exemple récent m’a particulièrement marquée. J’ai pris conscience de l’impact des odeurs sur mon corps. Je ressens maintenant avec une clarté nouvelle à quel point certaines signatures olfactives artificielles me sont devenues insupportables. Dans certains lieux – hôtels, supermarchés, espaces publics – mon corps réagit vivement, et je suis parfois obligée de partir. À l’inverse, j’ai vécu un choc olfactif avec Paysan Parfumeur. Cet artisan parfumeur a recréé un humus vivant, une matière en décomposition naturelle qui exhale l’odeur du « pétrichor », cette senteur de forêt après la pluie. Ce parfum vivant, issu d’un sol qui se transforme réellement sous l’action de micro-organismes, m’a bouleversée. Il a soulevé en moi quelque chose de très profond. Une émotion brute, pure, qui a surgit de manière puissante. Depuis, je suis en quête de ces odeurs qui saisissent, qui réveillent le cœur en sursaut.
Articles similaires
- All
- Arts visuels & Art de vivre
- Cinéma & Audiovisuel
- Édition
- Jeux vidéo
- Mode & Création
- Musique & Spectacle vivant